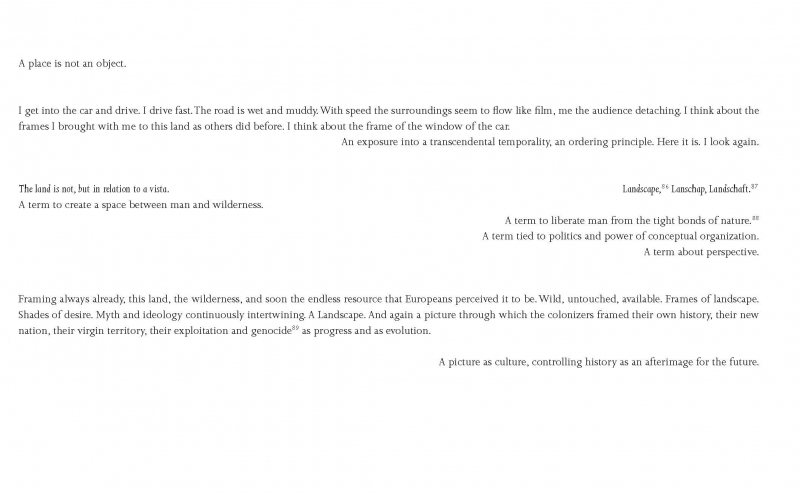Ignorer ou négliger l’expérience superposée des Orientaux et des Occidentaux, l’interdépendance des terrains culturels où colonisateurs et colonisés ont coexisté et se sont affrontés avec des projections autant qu’avec des géographies, histoires et narrations rivales, c’est manquer l’essentiel de ce qui se passe dans le monde depuis un siècle1.
Reconstruire notre incapacité à voir
Le cadrage de la photographie est relativement serré. Les trois quarts supérieurs sont occupés par la base d’un arbre au tronc divisé en plusieurs branches d’où une multitude de rejets s’échappe pour aller s’ancrer dans un sol jonché de feuilles mortes et de branchages qui occupe, lui, le quart inférieur de l’image. L’arrière-plan laisse entrevoir ce qui semble être une forêt assez dense. Posés au pied de l’arbre et à même son tronc, dix carrés de taille identiques maintenus par les rejets viennent perturber cette nature tortueuse par leur planité et leurs angles droits. Certains de ces carrés semblent recouverts du vert des feuilles que l’on aperçoit à l’arrière-plan, d’autres contiennent des fragments de blanc. Celui qui est au centre de l’image, suspendu dans les ramifications, nous frappe par sa blancheur éclatante. On devine alors qu’il s’agit de miroirs reflétant ce qui se trouve hors-champ, derrière le photographe.
Robert Smithson, de la série Yucatan Mirror Displacements, 1969.
Épreuve chromogénique en couleur, 61 x 61 cm,
coll. Solomon R. Guggenheim Museum, New York
© Holt-Smithson Foundation /Licensed by VAGA, New York.
Yaxchilan, Chiapas, Mexique. C’est dans ce lieu qu’en avril 1969 l’artiste américain Robert Smithson installa un dispositif destiné à former le septième élément d’une série connue sous le titre de Yucatan Mirror Displacements. Le principe en est simple. Smithson choisit neuf sites différents répartis entre le Chiapas et la péninsule du Yucatan sur lesquels il alla, successivement, disposer douze miroirs carrés selon un arrangement qu’il photographiait puis démantelait pour en réaliser un autre sur le site suivant, et ainsi de suite. Les photographies demeurent les seules traces de ces installations éphémères.
Souvent présentée dans la lignée de ses earthworks et travaux photographiques, cette série n’en possède pas moins une réflexion critique sur les rapports de domination entre Blancs et populations mayas. Yucatan Mirror Displacements s’est construit en réponse à la célèbre expédition de l’écrivain voyageur américain John Lloyd Stephens en Amérique centrale entre 1839 et 1842 à la recherche des sites mayas oubliés. Célèbre parce qu’une grande partie des objets mayas présentés à l’American Museum of Natural History de New York provient de ce voyage2, mais également parce que, à son retour, Stephens publia un récit de ses découvertes dans un ouvrage illustré de gravures, réalisées par son compagnon de route l’Anglais Frederick Catherwood et qui firent école dans le domaine de l’illustration architecturale3. L’apparente indifférence des autochtones vis-à-vis de la conservation de leur patrimoine choquait Stephens et, ce qu’il considérait comme de la paresse indolente était pour lui, indubitablement, la cause de l’effondrement de la civilisation précolombienne. Croire que seule la civilisation occidentale est à même de venir en aide sinon de sauver des ténèbres les autochtones, légitimant ainsi l’entreprise colonialiste, était une posture courante à l’époque.
Outre Catherwood chargé de réaliser des croquis des temples mayas, un médecin, le docteur Samuel Cabot, chirurgien et ornithologiste originaire de Boston, prit également part à l’expédition. Ce dernier avait mis au point une intervention chirurgicale soignant le strabisme et traita ainsi de nombreux autochtones grâce à ses expérimentations. Pathologie pour les Occidentaux, également appelé lazy eye en anglais (œil paresseux), le strabisme était cependant un signe de beauté et de lignée royale chez les Mayas qui cherchaient à le provoquer en plaçant une perle sur le front des enfants4. L’usage de l’expression lazy eye offrait l’occasion aux Occidentaux d’appuyer leurs thèses paternalistes. Cette anecdote du strabisme souligne les clivages culturels et l’obsolescence de tout système normatif lors du déplacement d’une culture à une autre.
Lorsque Smithson prit connaissance de ce récit, il saisit que la posture impérialiste adoptée par les membres de l’expédition était étroitement liée à celle de la vision qui devenait un « dispositif autoritaire5 » revêtant ici toutes les dimensions, qu’elles soient politique, culturelle, épistémologique ou physiologique. Avec Yucatan Mirror Displacements, qu’il considérait comme une anti-expédition6, Smithson s’était attaché à déconstruire cette vision unique par l’usage de miroirs renvoyant, entre autres, à sa lecture de La Pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss : « Le propre de la pensée sauvage est d’être intemporelle ; elle veut saisir le monde à la fois comme totalité synchronique et diachronique, et la connaissance qu’elle en prend ressemble à celle qu’offrent, d’une chambre, des miroirs fixés à des murs opposés et qui se reflètent l’un l’autre (ainsi que les objets placés dans l’espace qui les sépare), mais sans être rigoureusement parallèles7. » Smithson s’intéressait à cette pensée sauvage, cette forme de conscience dite primaire ou primitive, que Lévi-Strauss relie à ce qu’il identifie comme les « sociétés froides ». L’important pour Smithson était, à l’instar de cette conscience primaire, de se situer en léger décalage par rapport à une réalité. Et, grâce à une fragmentation du champ visuel, d’opérer un décentrement qui suggère la présence d’une multitude de points de vue, témoignant ainsi de l’impossibilité à fixer le regard en un point unique.
Bien que pensé en réaction directe à une histoire coloniale, ce projet ne peut cependant être considéré dans une perspective postcoloniale, au sens où l’entendrait la critique éponyme qui se développe depuis la fin des années 1970. La posture de Smithson pourrait être qualifiée de proto-postcoloniale puisqu’elle anticipe un axe critique développé ensuite au sein de l’art contemporain, néanmoins, elle s’ancre plutôt dans le postmodernisme naissant, dans la rupture avec « le triomphalisme scopique du modernisme8 ». Cette difficulté à qualifier clairement cette série est symptomatique de la confusion qui régnait jusqu’à la fin des années 1990 entre projet postmoderne et postcolonial9. Quoi qu’il en soit, il s’agissait de s’opposer à un mode de domination qui ici revêt le masque de la vision : Smithson exhorte à « reconstruire notre incapacité à voir » et à développer « une sorte d’anti-vision ou de vision négative10 » pour s’affranchir d’une vision et d’une histoire imposées. D’ailleurs, aucune vue de pyramide ou de tout autre élément culturel ou paysager pouvant conforter un stéréotype ne fait partie de la série réalisée au Yucatan. La leçon de Smithson nous enseigne cette nécessité de déconstruire une vision frontale et superficielle du lieu, et d’aller au-delà du cliché à la recherche de ce qui y est enfoui, invisibilisé.
Le lieu comme palimpseste
Si l’on considère que ce que l’on voit ou perçoit d’un lieu a quelque chose à nous dire d’une histoire, il serait alors à envisager comme un espace polyvocal. Un espace où le discours qui en émerge se nourrit des échos, des allusions, des paraphrases et des citations de discours antérieurs qui s’y tinrent. Michel de Certeau s’était attelé à démontrer ce rapport entre lieu et récit : « Les révolutions de l’histoire, les mutations économiques, les brassages démographiques s’y sont stratifiés et demeurent là, tapis dans les coutumes, les rites et les pratiques spatiales. Les discours lisibles qui les articulaient naguère ont disparu, ou n’ont laissé dans le langage que des fragments. Ce lieu, à sa surface, paraît un collage. En fait, c’est une ubiquité dans l’épaisseur. Un empilement de couches hétérogènes. […] Le lieu c’est le palimpseste11. » Chaque lieu possède donc une constellation de narrations, qu’elles soient orales ou écrites, que l’on peut s’employer à dénouer ou à tisser pour faire (re)surgir une autre histoire, oubliée ou tue, dissimulée ou ignorée. Il conviendrait ainsi de procéder à une sorte d’archéologie discursive du lieu.
L’idée du lieu comme palimpseste occupe une place cruciale chez les intellectuels et écrivains dits postcoloniaux. Ceux qui, comme Edward W. Said cité en exergue, cherchent notamment à relever les ambivalences et contradictions de la modernité et à écrire d’autres récits. Le lieu, ainsi que l’idée de déplacement qui lui est rattachée, les intéresse car il est considéré comme le fruit d’interactions entre langues, histoire et environnement. Dans un sens, le lieu est langage, un flux constant, un discours en processus qui ne peut donc être univoque et conduit à penser le lieu comme un palimpseste. C’est une idée essentielle pour comprendre que la géographie, en tant que discipline, est constituée par une série d’effacements et de sur-écritures qui ont transformé le monde, mais que l’histoire doit aussi être envisagée de la même façon. L’histoire n’est autre qu’un outil de construction d’une réalité. Adopter une position postcoloniale par rapport à cette discipline ne consiste pas à la rejeter et à y être opposé, mais à prendre en compte le fait que posséder une histoire (officielle) c’est détenir une existence légitimée. Il convient alors d’interroger son origine et de réinscrire l’hétérogénéité des représentations historiques, en passant notamment par une déconstruction du lieu, scène pour la mise en place des récits dits historiques.
Le concept d’histoire spatiale, basé sur l’idée de lieu comme palimpseste, cherche précisément à contourner l’histoire comme narration «scientifique » d’événements. Paul Carter développe cette méthode dans The Road to Botany Bay12, une critique du mythe fondateur de l’Australie qui deviendra un classique dans le domaine de la géographie culturelle et historique. Il interroge notamment la toponymie, un des marqueurs importants des explorations et de la conquête coloniale. En effet, nommer est une action fondamentale dans le processus colonial car il signifie autant s’approprier que définir et capturer le lieu par cet acte de langage. L’histoire spatiale commence ainsi par l’action de nommer : « Par l’acte de toponymie, l’espace est symboliquement transformé en lieu, c’est-à-dire un espace avec une histoire13 ». Le début de l’ouvrage de Carter est à ce titre éloquent : « Botany Bay : si nous croyons le nom, l’endroit est encore reconnaissable. Mais l’est-il ? Avant le nom : à quoi ressemblait le lieu avant qu’il ne soit baptisé ? De quelle façon Cook le perçut-il ?14 » La question du voyage est un élément fondamental à prendre en compte dans la constitution d’une histoire spatiale. Souvenons-nous que la première responsabilité de l’explorateur était de décrire ce qu’il avait sous les yeux. Or celui-ci se trouvait face à des lieux inconnus, une flore, des paysages, une faune et des autochtones complétement étrangers à ses connaissances antérieures, inadéquates à les décrire sans risquer de tomber dans la comparaison avec le connu. Une dissonance entre le langage employé et le lieu décrit était inévitable ce qui explique souvent l’étrangeté d’un nom désignant un lieu qui ne renvoie en apparence en rien à ce qu’il est censé définir.
Lieu et construction identitaire
Le projet Spiral Lands (2007) de la photographe allemande Andrea Geyer, particulièrement remarqué à la documenta 12, s’inscrit dans la continuité de ses travaux antérieurs sur les questions d’identité nationale, d’ancrage territorial et de citoyenneté aux États-Unis d’Amérique15. De la rencontre fortuite avec une femme navajo lors d’un voyage en voiture entre Los Angeles et New York naquit ce projet de questionner la problématique de la terre (Land) et de l’identité dans cette région du sud-ouest des États-Unis que sont les terres navajos. Andrea Geyer établit une historiographie visuelle et textuelle considérable, s’articulant autour de la justice sociale en Amérique du Nord. C’est une œuvre d’une richesse rare, constituée de multiples strates et niveaux de lecture, à l’instar de l’objet qu’elle s’est donnée d’étudier. Regroupant divers éléments provenant d’archives (citations de textes officiels émanant du gouvernement ou d’organisations de résistance natives, de rapports d’entreprises, de récits consignés), de textes variés (poésie, anthropologie, histoire) ou d’autres créés directement par l’artiste (photographies, notes de voyage), Spiral Lands permet de prendre la mesure de la complexité qui entoure ces lieux. Des images mentales viennent peu à peu remplacer les photographies de Geyer.
Andrea Geyer, de la série Spiral Lands / Chapter 1, 2007
Cadre 70 × 175 cm, installation avec tirages papier et texte, brochure avec notes de bas de pages.
Courtoisie de la Galerie Thomas Zander et de l’artiste.
Deux paysages en apparence identiques forment le treizième dispositif. Dans un même cadre noir oblong, deux photographies en noir et blanc sont montées en vis-à-vis, à leur droite du texte. En haut, un énoncé : A place is not an object. Plus bas : Myth and ideology continuously intertwining. A Landscape. And again a picture through which the colonizers framed their own history, their new nation, their virgin territory, their exploitation and genocide as progress and as evolution16. Les photographies représentent un paysage désertique, la ligne d’horizon se situe à peine au-dessus du milieu du cadrage. Sur la première, une plaine herbeuse dont l’aridité ne fait aucun doute s’étend jusqu’à l’horizon. Celui-ci est déterminé par une longue avancée rocheuse rappelant un plateau, recouvert peut-être de quelques buissons. La seconde est presque identique si l’on n’y prête pas attention mais le point de vue a changé. C’est un autre plateau, un peu plus élevé que l’autre. À moins qu’il ne s’agisse du même, mais un plus loin, ou alors vu du côté opposé. Le ciel est lourd de nuages. Ces photographies appelleraient presque à une rêverie bucolique et poétique, pourtant, le texte qui les accompagne nous en défend. Au contraire, il nous incite à regarder différemment ces plaines, à tenter d’y déceler ce qui pourrait lui faire écho, l’expliquer.
Andrea Geyer, de la série Spiral Lands / Chapter 1, 2007
Détail, installation avec tirages papier et texte, brochure avec notes de bas de pages.
Courtoisie de la Galerie Thomas Zander et de l’artiste.
Ce qui à première vue n’est qu’un paysage contemplé devient rapidement un lieu par le montage mental qui s’effectue à la lecture du texte accompagnant la photographie. En effet, « un paysage qui montre des signes d’habitation devient un lieu, ce qui implique une intimité ; un paysage qui a été habité peut être un lieu s’il est exploré, ou rester un paysage si simplement observé17 ». Ici une proximité se tisse avec les paysages représentés par les photographies de Geyer. Elle nous permet d’en comprendre certains aspects et en quelque sorte de les habiter. De ne plus être à l’extérieur, en observateur nu, mais de se positionner à l’intérieur, de les faire devenir lieux. Et alors je m’assois, pas tout à fait sûre si j’éprouve le lieu ou l’image que je semble si parfaitement reproduire18.
Andrea Geyer, de la série Spiral Lands / Chapter 1, 2007
Détail, installation avec tirages papier et texte, brochure avec notes de bas de pages.
Courtoisie de la Galerie Thomas Zander et de l’artiste.
Même si l’acte de nommer un lieu est en lui-même problématique car il renvoie à une pratique colonialiste, la toponymie commue ici des paysages anonymes en lieux emprunts d’histoires : Bandelier National Monument, Long House Ruins, Sisnaajiní (Mount Blanca), Dokó Ooslííd (San Francisco Peaks), Frijoles Cañon, Dibéntsaa (Mount Esperus), Acoma, Turtle Island, Tsé-bit-A’i (Shiprock). En regard des images de ces montagnes, plaines, canyons, parois rocheuses, les textes choisis et compilés par Geyer offrent la possibilité de multiples narrations, combinant poétique et politique. On y apprend notamment l’importance de la montagne dans la cosmogonie du peuple navajo. Diné Bahane, l’histoire de la création navajo, veut que quatre montagnes et quatre rivières furent données au peuple pour délimiter Dinétah, le territoire navajo, un lieu protecteur hors duquel tout Navajo se sent non seulement étranger mais vulnérable. Au regard de cette mythologie, l’expulsion du peuple Navajo hors de Dinétah lors de la conquête de l’Ouest prend alors une autre dimension. Cette expulsion visait à effacer toute trace de la présence navajo sur leurs terres, évinçant leur histoire en faisant de ces espaces des lieux symboliques de la conquête de l’Ouest, tout en leur refusant la possibilité de faire partie de la nation. En effet, « si un groupe est exclu de ces paysages d’identité nationale, alors il est largement exclu de la nation elle-même19 ». L’exclusion du récit passe par celle du lieu qui sert la construction de ce récit. L’articulation entre lieu et construction identitaire prend ici tout son sens.
De ces quatre montagnes aujourd’hui, nous connaissons surtout Tsoodził, la montagne turquoise rebaptisée Mount Taylor, représentant le point cardinal sud de Dinétah. Il s’agit en effet de la plus grande mine d’uranium-vanadium exploitée au monde mais c’est aussi paradoxalement le lieu d’un quadrathlon prisé20. La terre sacrée du peuple navajo n’existe plus que dans les légendes et les esprits. Les lieux photographiés par Geyer se teintent alors de mélancolie et d’amertume. L’usage du noir et blanc qui évoque la grande tradition de la photographie documentaire souligne cette nostalgie. Les images de Geyer peuvent à première vue renvoyer à celles stéréotypées de la conquête de l’Ouest : de grandes étendues « vides », une terra incognita ou terra nullius à explorer et à s’approprier. Or, précisément en faisant le choix de s’attacher au lieu et de ne pas photographier des Navajos, Geyer évite les clichés et l’ambivalence de la représentation de l’Autre. Une position d’autant plus équivoque dans le contexte de l’Ouest américain où enregistrer, documenter, recenser, renvoient aux pratiques ethnographiques et scientifiques qui accompagnaient celles du colonialisme. Comme chez Smithson où pas un stéréotype de la culture maya n’apparaît, pas un Navajo ne figure sur les images de Geyer. Et pourtant, c’est bien l’histoire et la mémoire de ce peuple qui vivait sur ces terres qui apparaît en filigrane. L’Autre ici se surimpressionne au lieu photographié, grâce à toute la documentation afférente réunie par Geyer qui permet d’en tracer un portrait en creux. Spiral Lands insiste sur la relation entre ces lieux en apparence désertiques et hostiles, par ailleurs symboles de la conquête de l’Ouest, et une identité navajo intrinsèque.
Dans les fréquences basses
Assumer que le lieu est composé de strates, de feuilles à déplier pour y lire et y écouter les multiples voix dont il est le gardien désigné, c’est le penser comme palimpseste mais également envisager son hétéroglossie21. Le problème de celle-ci réside justement dans cette hétérogénéité des voix, et surtout dans la mise à nu de celles qui émettent dans les fréquences basses, pour reprendre une expression du narrateur « invisible » du roman de Ralph Ellison22. Les voix marginalisées, subalternes, celles qui, écrasées par le poids de récits hégémoniques, sont contraintes au murmure. Ce sont celles qu’il nous faut extraire et écouter afin de contrer une vision et une connaissance unilatérales. Cependant le lieu ne parle pas. Pas dans une forme de rhétorique audible à notre oreille. Comme l’avait souligné de Certeau, le principe de coexistence forme le lieu. Celui-ci est configuré par des éléments qui possèdent leur place propre, ils sont « les uns à côté des autres23 ». Certains sont cachés par d’autres qui ont été grossis, amplifiés, mis en avant, sciemment ou par l’érosion du temps et des mémoires. Rester à la surface du lieu, ne pas entrer dans sa densité, suppose que certains de ces éléments resteront à jamais dissimulés. Notre savoir ainsi que notre vision ne s’attarderont que sur la partie émergée qui ne permet pas de saisir toute l’épaisseur du lieu, mais seulement un de ses nombreux aspects.
Presque quarante années séparent les séries Yucatan Mirror Displacements et Spiral Lands. Si la première est réalisée dans une optique postmoderne, la seconde rejoint les questionnements postcoloniaux en proposant une critique du colonialisme et de ses conséquences sur le peuple Navajo et ses terres. Conçues dans des contextes différents, elles soulèvent toutes deux la problématique de la représentation, au cœur du projet colonial, et la nécessité de la déconstruire, de la décoloniser. Par un travail critique sur un lieu précis, les œuvres comme celles de Smithson et Geyer relient les entreprises d’exploration aux phénomènes de la représentation, permettant de saisir les enjeux conjoints, de défaire les stéréotypes et d’amplifier les fréquences basses. Ce qui est important, ce n’est pas ce que l’on voit dans Yucatan Mirror Displacements et Spiral Lands, mais précisément tout ce que l’on ne voit pas.